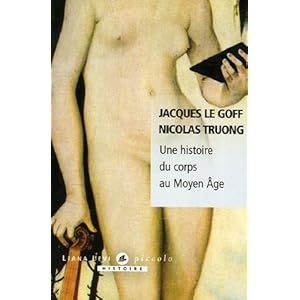Espace Cerveau – Station 8
Le corps en acte. Schéma corporel, Image du corps, Conscience du corps, Chair, Intersubjectivité, Perception… autant de notions encore au cœur des sciences ..
-
www.centrepompidou-metz.fr/frEn cacheLe Centre Pompidou-Metz est un centre d'art dédié à l'art moderne et ... Alain Berthoz, professeur au Collège de France, Chaire de physiologie de la perception ...
-
www.i-art-c.org/laboratoireespacecerveau/index.php?/stations/...En cacheCentre Pompidou-Metz ... Arnauld Pierre, historien de l'art, professeur à l'
Université Paris IV-Sorbonne ... Alain Berthoz, Ingénieur, psychologue, neurophysiologiste, professeur honoraire au ... reservations.spectacles@ centrepompidou-metz.fr ...
Initié par l’artiste Ann Veronica Janssens et Nathalie Ergino, directrice de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, ce projet Interdisciplinaire, rassemble les réflexions et les expériences d’artistes et de scientifiques (neurosciences, physique, astrophysique) ainsi que celles de philosophes, d’anthropologues, de théoriciens et d’historiens de l’art autour de l’espace et du cerveau. Invitée par le Centre Pompidou-Metz, l'équipe abordera l'exposition Erre, Variations Labyrinthiques comme sujet d'étude.
Cette conférence sera précédée d'une journée d'étude de 13:30 à 16:30.
Intervenants :
- Alain Berthoz, professeur au Collège de France, Chaire de physiologie de la perception et de l’action.
- Michel Lussault, géographe, professeur à l’Université de Lyon (Ecole normale supérieure Lettres et Sciences Humaines), membre de l’Unité Mixte de recherche CNRS 5600 Environnement, ville, société.
- Elisa Brune, écrivain (romancière, essayiste) et journaliste scientifique
- Denis Cerclet, anthropologue, maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2
- Arnauld Pierre, historien de l’art, professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne
- Jean-Louis Poitevin, docteur en philosophie, écrivain et critique d’art
- Pascal Rousseau, historien de l’art et commissaire d’expositions, maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (en attente de sa confirmation de participation)
- Nathalie Ergino, directrice de l'Institut d'art contemporain (Villeurbanne)
Le métier de mère

Le métier de mère
Un ouvrage de Séverine Gojard (La dispuste, Coll "Corps, santé, société", 2011)
Les mères sont confrontées après la naissance d’un enfant, à de nombreuses décisions. L’allaiter ou pas ? A heures fixes ou à la demande ? Quand appeler le médecin ? Auprès de qui faut-il prendre conseil ? Sa propre famille. son médecin. ses amies. les ouvrages scientifiques ou grand public : tous prétendent dire comment prendre soin de son enfant. mais sont loin d’être d’accord entre eux sur les méthodes pour y parvenir.
- La transmission familiale
- Les professionnelles de la petite enfance
- Les livres et la presse spécialisée
- L'évolution des conseils et des pratiques au fil des naissances
- Le modèle de la mère disponible au regard des conditions de vie
L'auteur en quelques mots... Séverine Gojard.
sociologue. chargée de recherche au laboratoire Alimentation et sciences sociales de l'INRA, analyse les ressorts de la prise de conseil, de la réception des normes de puériculture et de
leur application. à partir d'une enquête approfondie auprès de mères de jeunes enfants. Elle montre que les positions et trajectoires sociales des femmes déterminent en grande partie
l'orientation vers tel ou tel prescripteur.
Les recours aux conseils et leur mise en pratique varient en fonction des configurations familiales. parcours scolaires et contraintes professionnelles des mères mais aussi de leurs
savoir-faire préalables, particulièrement dans le domaine des soins aux jeunes enfants. L'auteur en quelques mots...
L'exploration cerébrale
Plusieurs articles scientifiques récents reprennent et discutent un tel projet. Les chercheurs ici rêvent et ils le savent. Mais ce rêve, ou ce fantasme, pose des questions fondamentales et passionnantes sur ce qu’on dénomme "pensée". Comment concevoir un lecteur de cerveaux ? Quelles seraient ses fonctions ? Quel usage en ferions-nous ? Comment transformerait-il les relations humaines ? C’est ce qu’il s’agit ici de chercher à comprendre, par le biais de la fiction, par exemple en en appelant à Proust et Hitchcock.
On rencontre en effet dans leurs œuvres ce que l’on pourrait appeler des scènes "critiques", véritables expériences de pensée permettant de mesurer la portée et de préciser les fonctions d’un lecteur de cerveaux".
Bien cordialement à tous,
Le corps de l'écrivain
The body upstream. The writer's body I
Opus - Sociologie de l'Art n°19
Paul Dirkx
Sous la direction
LITTÉRATURE ETUDES LITTÉRAIRES, CRITIQUES
Le dossier "Le corps de l'écrivain" réunit un ensemble d'études dont chacune met en valeur une ou plusieurs caractéristiques sociohistoriques du corps de l'écrivain, ou plutôt des corps des écrivains. Le présent volume se concentre sur "Le corps en amont", c'est-à-dire que l'accent est mis sur le corps de l'écrivain avant et pendant l'acte d'écriture.
The body downstream. The writer's body II
Opus - Sociologie de l'Art n°20
Paul Dirkx
Sous la direction
LITTÉRATURE ETUDES LITTÉRAIRES, CRITIQUES
Le présent numéro déplace plus nettement le regard vers le texte et invite à observer ce que celui-ci, en tant que littéraire ou métalittéraire, contient du corps de l'écrivain, voire fait au corps de l'écrivain.
L'envers du/des corps

http://www.teraedre.fr/product.php?id_product=132
Pris dans les rapports sociaux de pouvoir, le corps subit, ploie, se courbe, se redresse, se transforme, se cache, se déguise, invente : il est fabriqué par le dehors tout autant qu’il agit sur le réel. Le corps est un espace de production de sens dont il faut faire la géologie car il donne à voir, sous ses multiples couches, bien d’autres choses que du biologique.
Ce livre est une invitation à découvrir le travail de jeunes anthropologues qui ont choisi le corps humain comme levier méthodologique pour analyser leurs sujets de recherche respectifs. Dans différents lieux du monde, ils interrogent la dimension corporelle, sensible et émotionnelle de la construction identitaire et de la fabrication du lien au territoire, à l’autre humain ou à l’autre divin. Des mécanismes de contrôle des corps à la subversion du pouvoir par le corps, des techniques d’incorporation du sacré à la constitution émotionnelle d’une communauté de fidèles, de la mise en scène à la mise en image du corps, les articles ici réunis mettent en évidence la fonction cognitive du corps et la diversité hétéroclite des domaines où s’applique ce langage particulier qui s’énonce et s’oublie dans un même élan.
Didier Laurencin est allocataire de recherche en anthropologie à l’université Lumière Lyon-2.
PRIX EN SOUSCRIPTION : 14,50 €
Le corps et ses représentations à l’époque romane
|
|
Appel à contribution - Le corps et ses représentations à l’époque romane
Vingt-troisième colloque d’Issoire (19-21 octobre 2012)
Mardi 15 mai 2012 | Issoire (63500)
Le vingt-troisième colloque d’Issoire consacré à la période romane aura lieu à Issoire les 19, 20 et 21 octobre 2012. Le thème retenu cette année par le comité scientifique est « Le corps et ses
représentations à l’époque romane ». Si l’histoire du corps a fait l’objet de nombreuses publications ces dernières années, un petit nombre d’entre elles sont consacrées au Moyen Âge,
essentiellement pour ses derniers siècles qui auraient vu les prémices de la « découverte » du corps. Ce colloque sera donc l’occasion d’évaluer l’appréhension du corps pour les périodes plus
anciennes, de réfléchir aux pratiques liées au corps, mais aussi de revenir sur les caractéristiques et les motivations de sa représentation.
La tribune du colloque d’Issoire a, depuis plus de vingt ans, vu se succéder de nombreux chercheurs français et étrangers comme Xavier Barral i Altet, Christian Davy, Alain Erlande-Brandenburg,
Yves Esquieu, Pierre Garrigou-Granchamp, Andreas Hartmann-Virnich, Miljenko Jurkovic, Jacek Kowalski, Victor Lassalle, Jacqueline Leclercq-Marx, Jean-Michel Leniaud, Guy Lobrichon, Anne Prache,
Nicolas Reveyron, Daniel Russo, Alain Salamagne, Éliane Vergnolle, Pierre Vaisse, Giovanna Valenzano, Jean Wirth…
Les Actes des colloques font l’objet de publications régulières dans la Revue d’Auvergne, organe de l’Alliance Universitaire d’Auvergne, diffusant les recherches des deux universités de
Clermont-Ferrand.
L’histoire du corps a fait l’objet de nombreuses publications ces dernières années. Toutefois un petit nombre d’entre elles sont consacrées au Moyen Âge, et le plus souvent c’est la fin du Moyen
Âge qui est abordée, qui aurait vu les prémices de la « découverte » du corps. Cela voudrait-il dire que pour les périodes plus anciennes l’appréhension du corps était bannie, qu’elle serait hors
sujet ? Pourtant les œuvres figurées représentent à foison des hommes, des femmes, dont la corporéité est la base même de la représentation. Ce colloque devrait donc nous permettre de nous
interroger sur cette question du corps et de ses représentations à l’époque romane.
Le corps d’après l’archéologie
Au premier degré de la connaissance, celle d’une réalité matérielle disparue, c’est avant tout l’archéologie funéraire et l’anthropologie qui, par l’analyse scientifique des restes humains
découverts dans les fouilles, permettent de juger sur pièces de l’état physique, morphologique, voire physiologique, d’une population, de l’âge de l’inhumation des défunts, de leur état de santé
au moment du décès. Mais la pratique archéologique permet aussi d’aller plus loin dans la connaissance de la conception qu’avait l’homme à l’époque romane du corps périssable. Dans la mesure où
les hommes ont été enterrés selon certains rites (liturgie, mais aussi position, orientation, vêtement, objets d’accompagnement), ils transcrivent une certaine conception de la réalité charnelle,
un rapport au corps, le corps dont la Bible affirme qu’il redeviendra poussière, mais aussi qu’il ressuscitera, tandis que l’âme, qui s’en détache au moment de la mort, survivra.
Représentations
Ce rapport au corps nous est toutefois parvenu à l’époque romane moins par des témoignages directs que par des « représentations ». Représenter, c’est replacer devant les yeux un objet, le corps,
à travers le prisme déformant des images, mais aussi des textes (documents d’archives) et de la littérature, de la pensée philosophique. Visuelles, artistiques, mais aussi mentales, toutes ces
représentations passent par des constructions qui doivent poser la question de l’écart entre réalité et représentations. Elles manifestent l’instrumentalisation du corps : le corps comme « objet
», permettant de parler d’autre chose que du seul corps.
Les apparences du corps
Les âges de la vie.
C’est l’homme adulte qui est le plus généralement représenté. Mais qu’en est-il de l’enfant, du vieillard ? Quelle conception de la jeunesse ou de la vieillesse les représentations du corps
véhiculent-elles au sein de la société romane ?
Le corps sexué.
Comment l’homme et la femme sont-ils distingués, typés, marqués ? Si le sexe masculin est privilégié, est-ce le simple « reflet » d’une réalité sociale contribuant à l’affirmation de sa
supériorité ? L’homme supérieur, la femme subordonnée. Ces représentations servent-elles nécessairement l’entretien et la diffusion d’un discours culpabilisant, renvoyant le fidèle à
l’interprétation de la Genèse par l’Église, qui incombait à Ève la principale responsabilité de la Faute ? L’œuvre d’art pourrait être alors conçue et vécue comme un moyen de propagande. De façon
plus générale, est-ce que, au regard des représentations, l’expression de Georges Duby « Mâle Moyen Âge » se justifie ?
Le corps dans tous ses états.
Le corps est d’abord la représentation matérielle de la vie, de la vie terrestre. Toutefois il est corruptible. Comment la douleur (corps violenté, jusqu’au martyre), la maladie (corps sain/corps
malade), la douleur (physique, mais aussi mentale), la mort et la décomposition (corps vivant/corps mort), mais aussi le corps disparu et reconstitué (apparitions, fantômes, êtres surnaturels)
sont-ils représentés, entre constat d’une réalité primaire et interprétation symbolique ?
Le corps comme manifestation concrète et visible de la vie.
Le corps est un objet fait de chair et de sang. Il est en mouvement et ce mouvement est la manière la plus adéquate de signifier la vie, par les gestes, rituels ou non, par le déplacement dans
l’espace (liturgie, processions, pèlerinages), par la danse (récréative ou liturgique, permise ou répréhensible).
La représentation du corps comme représentation culturelle de l’homme roman
L’être humain est vu sous ses différentes facettes à la fois physiques, mais aussi et surtout morales et symboliques. Les images du corps humain, selon qu’elles montrent un aspect « normal » ou
difforme, monstrueux, sont le vecteur des valeurs souvent contraires qui lui sont attachées. Cette opposition entre corps « normal » et corps « déformé », pose la question de la nature de la
Création divine, expression de l’ordre opposé au désordre, du Bien opposé au Mal. Il pose aussi la question de l’autre, celui que l’on ne connaît pas et que l’on imagine par voie de conséquence
comme différent (les peuples lointains, les peuples païens, les « hérétiques »). Mais que signifient « normalité » et « difformité » ? Surtout lorsque le principe même de l’art roman est non pas
de représenter la nature sous ses aspects les plus immédiatement sensibles, reconnaissables, mais d’évoquer la nature profonde de l’être humain, de représenter l’invisible par le visible ? Quelle
crédibilité accorder à une expression artistique – l’art roman – dont le « réalisme » n’est pas, tant s’en faut, la principale caractéristique ? Que penser des évocations romanesques ou
poétiques, lorsque la littérature use de procédés rhétoriques pour tenir en haleine le lecteur ou l’auditeur, pour faire appel à son imagination ?
Le corps comme métaphore
Le corps est aussi symbole et symptôme d’autre chose que ce qu’il montre. Le corps forme un tout, il présente un caractère organique. Par analogie, selon une idée qui se développe au XIIe siècle,
le corps devient microcosme. Chaque membre désigne par exemple le pouvoir (la main qui bénit et protège, mais aussi qui condamne), chaque partie du corps devient le siège d’une spécificité
humaine (la tête, siège de l’âme).
Le corps est la métaphore de l’Église : l’Église est comme un corps, dont le Christ est la tête.
Le corps est la métaphore de la société (le corps social).
La valeur esthétique du corps ?
À l’inverse de l’Antiquité grecque, le Moyen Âge a refusé le culte du corps et sa valeur esthétique. Pour autant, l’adoption du dogme de l’Incarnation conduit à considérer le corps humain comme «
le lieu de réalisation du divin » (Schmitt). Le corps est ainsi glorifié. Se pose alors la question de la beauté du corps. L’œuvre d’art, et en particulier la représentation des corps, ne se
veut-elle pas l’expression même d’une certaine beauté ? Qu’en est-il en particulier de la beauté féminine ?N’oublions pas, non plus, que l’homme a été créé par Dieu à son image. Le corps humain
est assimilé à la Créature, comme œuvre de Dieu. Il prend alors une importance capitale et revêt des dimensions symboliques puissantes et variées. Mais le corps est-il pour autant idéalisé ? Et
si oui, en quoi consiste cette idéalisation ?
Le corps et la morale
Qu’en est-il du rapport du corps à la morale ? Le corps dans toute sa normalité ou sa beauté, apparaît comme le miroir d’une vie conforme aux usages, aux commandements de l’Église. Tandis que le
monstre, l’hybride apparaît comme l’antithèse. La beauté physique du corps peut-elle être le révélateur d’une beauté spirituelle ? Si le Moyen Âge roman a refusé de reconnaître la valeur
esthétique du corps en lui-même, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été mis en exergue par les œuvres d’art comme la source d’une sensation, d’une émotion, sinon d’une transcendance et de
l’accès au divin (Suger).
La beauté d’un corps peut aussi être symbole de rédemption (Marie). Mais, à l’opposé, comment ne pas être sensible à la beauté de l’Ève d’Autun, par exemple ? Et pourtant celle-ci ne se veut pas
en principe l’expression d’une perfection, pas plus corporelle que spirituelle. Beauté du diable, beauté divine ? Beauté trompeuse, illusoire, beauté vraie ?
Corps nu, corps vêtu. Pour des raison d’ordre moral, le nu est condamné par l’Église, mais « il reste au centre d’une tension entre dévalorisation et promotion » (Le Goff). Toutefois les
représentations de nus sont nombreuses dans l’art roman, oscillant entre la volonté de représenter l’innocence, la beauté morale, la réalité des origines (Adam et Ève) et la honte du péché (les
damnés lors du Jugement dernier), l’horreur du vice (la luxure). Le vêtement est à la fois parure et protection.
Le questionnement métaphysique
Cette perspective ouvre la question essentielle : Dieu a-t-il un corps ? Peut-il alors être « représenté » (voir la querelle des images et les tendances aniconiques) ? Quel corps pour quel Dieu ?
Le corps mystique qui se réalise dans l’Eucharistie.
Corps humain, corps divin, quelle différence ?
L’analyse du corps ne peut échapper à la question du rapport entre l’âme (l’esprit) et le corps, entre monde matériel et immatériel, entre le sensible et l’intellect. Quel rapport entre l’âme et
le corps ? Opposition ? Complémentarité ?
Comité scientifique:
* Ourdia Touhari , maire-adjoint d’Issoire et présidente de l’association «Terres Romanes d’Auvergne»
* Anne Courtillé, professeur émérite à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
* Jean-Luc Fray, professeur d’Histoire médiévale à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
* David Morel, Chargé de Recherche F.N.R.S. – Université de Namur
* Martine Jullian, maître de conférences à l’Université de Grenoble
* Pierre Deneuve, directeur du Centre d’Art Roman « Georges Duby » d’Issoire
* Pascale Chevalier, maître de conférences à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
* Annie Regond, maître de conférences à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
Modalités:
Le voyage, les repas et le logement des communicants sont pris en charge par Terres Romanes d’Auvergne. La publication des Actes est assurée par l’Alliance Universitaire. Une excursion le
dimanche 23 octobre vous sera également offerte.
Nous sommes naturellement à votre disposition pour tout complément d’information.
Voici le déroulement souhaité par le comité scientifique :
* Date limite d’envoi des propositions de communications : 15 mai 2012 (titre, éventuellement provisoire, et bref résumé).
* Réunion du conseil scientifique et élaboration du programme : début juillet 2012. Vous recevrez aussitôt un courrier vous avisant de la décision du conseil scientifique.
* Envoi des résumés : 1er octobre 2012.
* 19-20-21 octobre 2012 : colloque et excursion.
* 15 février 2013 : envoi des textes définitifs pour publication. (nous vous serions reconnaissants, si vous acceptez de participer au colloque, de bien vouloir dès maintenant
anticiper cette contrainte dans votre emploi du temps).
* Octobre 2013 : publication des Actes.
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le bulletin (voir pièce jointe) avant le 15 mai 2012 par mail à davmorel@sfr.fr ou
annie.regond@wanadoo.fr.
Espérant une réponse favorable de votre part, nous vous prions de recevoir, cher collègue, chère collègue, nos salutations les meilleures.
David Morel, Chargé de Recherche F.N.R.S. – Université de Namur
Annie Regond, Maître de conférences à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, Enseignante-associée à l’École de Chaillot. 06 87 01 25 32
* Issoire_2012.doc
Contact
* David Morel
courriel : david [point] morel (at) fundp.ac [point] be
61 rue de Bruxelles
5000 Namur
Le corps mongol

LE CORPS MONGOL
Techniques et conceptions nomades du corps
Gaëlle Lacaze
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, CIVILISATION ASIE ASIE CENTRALE Mongolie
Le corps mongol examine les techniques et les conceptions du corps des peuples mongols. Dans les conceptions de la personne et les usages du corps de ces peuples, l'animal élevé, et surtout le cheval, occupe une place essentielle. Cette relation implique des manières d'être, de penser et d'agir spécifiques que le lecteur est invité à découvrir en suivant deux axes de lecture : un axe diachronique lié au cycle de vie et un axe synchronique relatif au rapport à l'espace.
ISBN : 978-2-296-56012-3 • février 2012 • 354 pages
Prix éditeur : 33,5 € 31,83 € / 209 FF
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=...
Esther Ferrer et Video Vintage
Cette exposition inédite, construite à partir d'une sélection de bandes fondatrices de l'art vidéo de la collection
Castellano | Euskara
Espagnole, peintre et plasticienne à l'origine, Esther Ferrer se co
nsacre exclusivement aux performances depuis qu'elle a rejoint, en 1966, Juan Hidalgo et Walter Marchetti au sein de Zaj, groupe d'art-actio
n anti-franquiste, né au début des années 60.
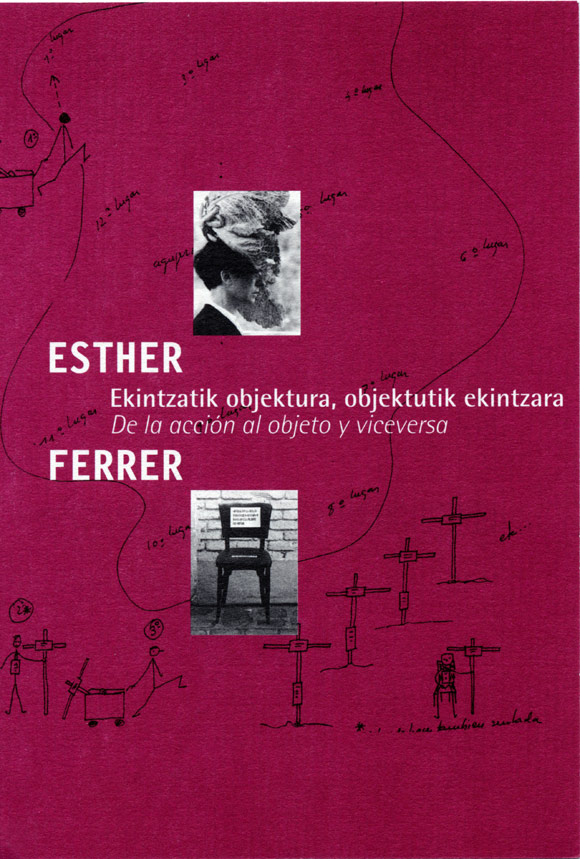
|
Espagnole, peintre et plasticienne à l'origine, Esther Ferrer se consacre exclusivement aux performances depuis qu'elle a rejoint, en 1966, Juan Hidalgo et Walter Marchetti au sein de Zaj, groupe d'art-action anti-franquiste, né au début des années 60.
Espagnole, peintre et plasticienne à l'origine, Esther Ferrer se consacre exclusivement aux performances depuis qu'elle a rejoint, en 1966, Juan Hidalgo et Walter Marchetti au sein de Zaj, groupe d'art-action anti-franquiste, né au début des années 60.Espagnole, peintre et plasticienne à l'origine, Esther Ferrer se consacre exclusivement aux performances depuis qu'elle a rejoint, en 1966, Juan Hidalgo et Walter Marchetti au sein de Zaj, groupe d'art-action anti-franquiste, né au début des années 60.