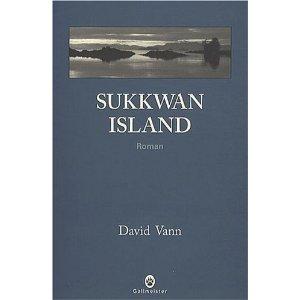
La violence des femmes
La violence des femmes apparaît comme un tabou social et historique.
La femme brutale est forcément très minoritaire, très masculine, un peu sorcière, cruelle ou atteinte pathologiquement. Elle sort du rôle maternel, soumis ou
victimiste que la société assigne à la femme depuis des générations. Or la violence n'est pas si sexuée qu'on le croit ; l'Histoire le démontre, ainsi que les chiffres en matière de délinquance
et de crimes ou les témoignages encore timides d'hommes battus.
Il s'agit pour l'auteur de décrypter cette réalité et d'en tirer les conséquences sociales et juridiques. Pourquoi la justice, à crime égal, ne condamne-t-elle pas
l'homme et la femme de la même manière ? Infanticides, pédophiles, complices volontaires de leur compagnon : Christophe Régina s'appuie sur de nombreux exemples historiques ainsi que sur une
enquête qu'il a lui-même menée auprès d'une centaine de personnes pour dépasser les stéréotypes de genre et interroger la place de la femme dans la société.
Colloque Marcel Jousse
« A la recherche de l'homme vivant : une rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes autour de l’anthropologie linguistique de Marcel Jousse (1886-1961) »
Ce colloque est organisé par le groupe de recherches CORPS-À-DIRE sous la responsabilité scientifique de Claudine Olivier, Maître de Conférences en Sciences du langage (CEL, EA 1663, Lyon-3).
Il s'agit d'une rencontre interdisciplinaire entre chercheurs, praticiens et artistes autour de l'anthropologie linguistique de Marcel Jousse (1886-1961).
Auteur d'une oeuvre scientifique inclassable, mais qui a modifié en profondeur les pratiques de ceux qui se sont reconnus en elle, tous domaines confondus, Marcel Jousse est resté peu connu. Son programme de recherches trouve pourtant des échos et une validation dans les développements de la science actuelle sur le corps, le mouvement, les émotions et les perceptions.
Le colloque accueillera 47 intervenants de 8 pays différents, et différents formats d'interventions : conférences académiques, exposés de méthodes, études de cas cliniques, études de cas en milieux ethniques traditionnels et performances artistiques.
Il constituera une plate-forme intéressante de dialogue problématisé entre les disciplines et les cultures, entre l'Université et le monde professionnel et associatif.
Le colloque s'inscrit dans une dynamique appelée à répondre à une demande sociale pressante. L'Université se devait de rendre compte de cette dynamique, en donnant la possibilité à des chercheurs de formuler, depuis les formes qui sont les siennes, à propos d'un programme de recherches sur "corps et langage", des réflexions adaptées et méthodologiquement structurées.
De nombreuses disciplines sont concernées : Sciences du langage, Anthropologie, Langues et Civilisations, Lettres modernes et Lettres Classiques, Philosophie, Histoire, Sciences de l'Information et de la Communication, Sciences cognitives (embodied cognition), Neurosciences, Psychologie, Sciences de la Vie, Sciences de l'Education, Sciences du Sport, Arts du corps, Médecine, Cinéma, Sociologie, Mathématiques, etc.
Les interventions s'adressent aux chercheurs et aux acteurs sociaux, aux professionnels de santé (dont orthophonistes, kinésithérapeutes, phoniatres, psychiatres, spécialistes du handicap), des secteurs de l'éducation et du monde des arts, du développement durable, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à la vie dans le cadre de la Cité.
Vous trouverez le programme pour les 4 journées et les informations concernant l'inscription au colloque sur le site de l'Université Lyon-3 et à l'adresse http://colloquejousse2011.monsite-orange.fr
Renseignements : OLIVIER.Claudine@wanadoo.fr
Date limite d'inscription : 20 septembre 2011 - contact inscriptions : corinne.berger@univ-lyon3.fr
Inscription normale : 70 euros - tarif souscription jusqu'au 5 septembre (50 euros)
Tarif réduit (doctorants, demandeurs d'emploi) : 20 euros
Gratuité pour tous les étudiants de Licence et Master et pour tous les étudiants et les personnels BIATOSS de Lyon-3.
Vertides du corps et espaces de l'art
http://www.franceculture.com/emission-croisements-les-vertiges-du-corps-et-les-espaces-de-l’art-2011-08-21.html
Les vertiges du corps et les espaces de l’art
21.08.2011 - 14:00
Alain Berthoz, Philippe Petit, Roland Recht © RADIO FRANCE/COLLÈGE DE FRANCE
Quelle place occupe notre corps dans les espaces de l’art ? Notre corps de spectateur mais également celui représenté par les artistes. Ce corps en mouvement qui,
au fil de l’histoire de l’art, a sans cesse modifié le sens conféré au concept d’espace. Mais de quelle évolution témoignent au juste les différentes représentations plastiques de cette
corporéité ? La photographie, le cinéma, et aujourd’hui les arts numériques, ont-ils changé notre perception du corps ? Par ailleurs, avec la dématérialisation progressive des œuvres d’art,
l’espace traditionnel du musée est-il menacé ? Doit-il alors être repensé ? Autant de difficultés auxquelles Alain Berthoz et Roland Recht tentent d’apporter des réponses.
David Vann
LE MONDE DES LIVRES | 25.06.10 | 19h06 • Mis à jour le 08.11.10 | 12h13
25 juin 2010 – Le Monde.fr - "Sukkwan Island", prix Médicis étranger. L'auteur américain s'
Sukkwan Island raconte l'histoire d'un père et d'un fils partis pour un an vivre dans une cabane sur une île de l'Alaska. Le fils, âgé de 13 ans, est là contre son gré, il n'a pas osé dire non à son père, qu'il sait fragile. Les éléments sont hostiles, les carences du père abyssales, les relations père-fils épouvantables. Le lecteur sent que tout se terminera mal. Il est pris au dépourvu lorsque, finalement, tout se termine mal, mais de manière encore pire qu'il ne l'imaginait.
Dans le roman, le fils s'appelle Roy et le père Jim, diminutif de James. Comme dans la dédicace : "A mon père, James Edwin Vann, 1940-1980". James Vann, père de David donc, aimait les femmes, la pêche et la chasse. Quand son fils est né, il était dentiste sur une base américaine au milieu de nulle part, une île du nom d'Adak à l'extrême ouest de l'Alaska. La famille s'installe ensuite à Ketchikan, une petite ville de l'autre côté de l'Etat américain, près de la frontière canadienne. Mais James Vann est un homme infidèle. Les parents se séparent, le père reste dans ces froides contrées tandis que la mère, David et sa soeur s'installent en Californie.
L'enfant aussi aime la pêche et la chasse. Il rejoint son père tous les étés, attrape des saumons plus grands que lui. Un jour, alors qu'il a 13 ans, son père lui propose de venir passer une année en Alaska. Il refuse. Quinze jours plus tard, il est à la plage avec sa mère et sa soeur lorsque la famille reçoit un coup de fil : son père s'est tué d'une balle de pistolet.
Pendant quinze ans, David Vann sera insomniaque. La honte et la culpabilité le rongent. Son entourage ne lui est pas d'un grand secours psychologique : sa mère lui a offert les fusils de chasse de son père ! Il n'a pas vu la dépouille de son père, raconte autour de lui qu'il est décédé d'un cancer. "Je me sentais sale", dit-il avec le recul.
David Vann avait 19 ans lorsqu'il a entrepris le récit de ce traumatisme. Il commence par raconter la scène de la plage, le jour fatidique où la famille apprend le suicide du père. Ça ne fonctionne pas. Pendant dix ans, il tâtonne. Jusqu'à cette traversée en voilier, de la Californie à Hawaï, où il écrit sur le bateau, son ordinateur fixé par des bandes Velcro. En dix-sept jours, il tient la trame. Il a trouvé le ressort, le moyen de prendre sa revanche : il suffit d'inverser les rôles. Il ne l'a pas prémédité, il n'avait aucune idée du dénouement, ou plutôt du retournement de situation. "Je ne l'ai pas écrit sous contrôle, je ne m'en suis rendu compte qu'au milieu de la phrase, explique-t-il aujourd'hui. Après, je me suis dit que ça ne pouvait se terminer que comme ça." Revanche psychologique ? Thérapie ? Oui et non, parce qu'"un livre qui ne serait qu'une thérapie serait mauvais". Ici, "c'est aussi une question de beauté, dit-il sans fausse modestie. Il y a une esthétique dans l'écriture".
La publication du livre prendra encore plus de temps que sa gestation. Aucun agent n'en veut. Alors David Vann se résout à être autre chose qu'écrivain. Il voyage, écrit des reportages. Traverse les Etats-Unis en char à voile pour le mensuel américain Esquire. Raconte dans le Guardian l'histoire de sa famille, dominée par les femmes célibataires. Enseigne la littérature à San Francisco. Gagne sa vie comme marin. Publie des essais sur la voile, sur un massacre commis dans une école près de Chicago, puis sur un naufrage qu'il a vécu avec sa femme, Nancy, institutrice en maternelle, alors qu'ils voguaient sur un bateau qu'il avait lui-même construit...
Un beau jour, alors qu'il a perdu pratiquement tout espoir de voir Sukkwan Island publié, David Vann l'adresse à un concours de nouvelles, le Grace Paley Prize. Il gagne. Les Presses de l'Université du Massachusetts publient le texte avec quelques-unes de ses nouvelles en 2008, sous le titre Legend of a Suicide, mais à seulement 800 exemplaires. Il faudra une critique élogieuse dans le New York Times pour que l'éditeur américain Harper Collins rachète les droits.
James Vann s'est suicidé en 1980. Trente ans plus tard, son fils David connaît la consécration. Sukkwan Island est d'abord publié en France, où le public lui accorde plus que de l'intérêt : les éditions Gallmeister, petite maison de "nature writing" qui ne publie que des auteurs de l'Ouest américain, ont tiré 63 000 exemplaires en six mois. Le succès français a suscité un intérêt dans toute l'Europe. Le roman sera bientôt publié en Grande-Bretagne, des traductions sont achevées ou en cours en italien, en allemand, en danois, etc. Il enchaîne les tournées de promotion, répétant inlassablement le suicide de son père. Un autre se lasserait. Pas lui ? "Pas du tout, à chaque fois, c'est un autre moi !"
David Vann voit venir avec bonheur le jour où il n'aura plus besoin d'enseigner. Il vient de s'acheter un petit voilier sur la Côte d'Azur. Il a déjà écrit un deuxième roman, qui n'est pas encore publié, Caribou Island, dont l'intrigue se situe également en Alaska. Et il continue d'en écrire d'autres. Il sait raconter, et il sait pourquoi : "J'ai grandi dans une famille de menteurs, dit-il avec un grand sourire. Ils mentaient sur les histoires de pêche et de chasse, ils les enjolivaient, mais aussi sur les choses importantes. C'est un très bon entraînement pour écrire."
Dans la famille, c'est sa grand-mère qui l'a incité à lire et à écrire. La mère de son père. Après avoir lu Sukkwan Island, elle lui a envoyé une lettre. Elle lui disait trois choses : qu'elle avait pleuré pendant trois jours ; qu'il était "trop bête" d'avoir grandi sans respecter son père ; et qu'il devrait se tourner vers Jésus.
Sukkwan Island, de David Vann, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski, Gallmeister, 192 p., 21,70 €. Marie-Pierre Subtil
Herman Kolgen
http://www.itaucultural.org.br/on_off
PRIX ARS ELECTRONICA 2010 / HONORARY MENTION
A human body is injected in a cistern. Over the course of 45 minutes, the pressure of the liquid exerts upon him multiple neurosensorial transformations. From his
epidermal fiber to his nervous system, he reacts to influxes of viscosity in this liquid chamber. His cortex, lacking oxygen, gradually loses all notions of the real. Like a human guinea pig: a
matter-body whose psychological states are the object of kinetik tableaux, of singular temporal spaces.
The genesis of the principal visual material for this project was a shoot, in an immense cistern filled with water, which lasted six consecutive days. Yso had to be
immersed for over eight hours a day in the glass tank, oscillating between weightlessness and lack of oxygen. With the aid of various digital video recording and photographic systems Kolgen
assembled many series of temporal sequences, images that he then assembled into a flexible and modular body. It’s a matter of a narrative progression, in perpetual circles of influence and
movement, where the real is in dislocation.
INJECT is a modular performance in VIDEO HD format and multichannel audio.
SELECTED PERFORMANCES:::
TAIPEI_TAICHUNG_BRUXELLES_
FRANCE_MONTREAL_URUGUAY_ARGENTINA_PORTUGAL_ENGHEIN
ESPAGNE_ITALIA_AUTRIA_PHILIPPINES_NETHERLAND_GERMANY
CO-PRODUCTION
KOLGEN + ARCADI + CONSEIL DES ARTS CANADA
Herman Kolgen - official site
L’immersion corporelle dans l’imaginaire contemporain
Des images du corps aux mots du sujet : L’immersion corporelle dans l’imaginaire contemporain / From Body’s Images to Subject’s Words: The Bodily Immersion in the Contemporary Imaginary
FRANÇAIS
La culture populaire reflète les images d’un corps fantasmé, un corps idéalisé, un corps mis en culture par des rêves, des idéologies, des utopies, par un imaginaire du corps qui flirte entre l’hybridité et la perfection. Extension de pratiques, usages et représentations scientifiques ou artistiques qui chaque jour concrétisent ce corps nouveau, l’imaginaire contemporain met en avant la construction identitaire inhérente à ce renouveau du corps.
A partir d’une analyse pluridisciplinaire des discours et images impliqués et/ou développés autour de ces pratiques, nous souhaitons interroger la constitution d’un sujet corporel dont les formes et modalités d’existence trouvent leur source et leur potentiel de déploiement dans l’imaginaire. Hybridation, virtualisation, amélioration, incarnation, immersion ou subjectivation s’imposeront ainsi comme des grilles de lecture des liens qui se tissent entre les images du corps et les mots du sujet, liens renouvelant le rôle de l’imaginaire dans l’existence sociale et individuelle des sujets corporels contemporains.
ANGLAIS
Mainstream culture suggests images of a fantasized and idealized body. This “Cultural Body” is driven by dreams, ideologies and utopias: an Imaginary Body nesting between hybridity and perfection. Nowadays, scientific to artistic representations, practices and manners confirm this “new” body, rushing Contemporary Imaginary to its “body revival” identical build-up.
From a multidisciplinary analysis of speeches and images involved and/or developed around these practices, we question the constitution of a bodily subject, among which the forms and modalities of existence find their source and potential of deployment in the Imaginary.
Hybridization, virtualization, improvement, embodiment, immersion or personification are among the tools used to highlight the links between the Body’s Images to the Subject’s Words: links renewing the role of the Imaginary in social and individual existence of contemporary bodily subjects.
Paul Yonnet


Le sociologue et essayiste Paul Yonnet est décédé vendredi 19 août à l'âge de 63 ans, a annoncé sa maison d'édition Gallimard à l'AFP. Il était l'un des observateurs les plus pénétrants de la société contemporaine.
Paul Yonnet a écrit une dizaine d'ouvrages. Il avait la particularité de s'attacher à des petits faits négligés ou jugés marginaux par la science sociale officielle, tels que le tiercé, le jogging, le look ou encore les animaux de compagnie. Il en tirait un sens profond, prenant en compte le point de vue de leurs acteurs. Dans Jeux, modes et masses (Gallimard) publié en 1985, il décryptait ainsi le tiercé comme les "voies imprévues de l'adhésion aux rituels de la démocratie" (quatrième de couverture).
Observateur de la société à travers les loisirs
De manière générale, il s'est beaucoup intéressé aux sports et aux loisirs. Dans Travail, loisir: temps libre et lien social (Gallimard, 1999), il étudiait les différentes activités que l'augmentation du temps libre avait fait se développer. Dans Système des sports(Gallimard), il s'attaque au spectacle dans le monde sportif.
Il avait démarré un ouvrage sur la famille, dans lequel il en scrutait les métamorphoses. Mais il n'aura eu le temps de mener à bien qu'un premier volume, Le recul de la mort, l'avènement de l'individu contemporain (Gallimard, 2006), consacré aux effets de la vie longue et de la contraception sur le statut de l'enfance. Il avait en chantier un second volume, qui devait aborder les rapports hommes/femmes. Paul Yonnet écrivait également dans la revue Le Débat, dirigée par Pierre Nora et Marcel Gauchet.
Enfant de ce baby-boom sur lequel il n'a cessé de réfléchir, Paul Yonnet a fait ses études de sociologie à Caen et à Toulouse. Il a mené toute sa carrière au sein de l'Union nationale des associations familiales (UNAF), qui lui a fourni un observatoire privilégié sur les faits sociaux qui lui paraissaient les plus significatifs.
La fente d'eau
DANS UNE MAISON VIDE près d’un fleuve en crue, une jeune femme, enceinte, attend l’homme qu’elle aime et qui l’aime, dont nous ne saurons que le prénom, François.
Elle confie au magnétophone une sorte de confession hallucinée, afin d’essayer de lutter contre l’angoissante sensation qu’elle subit d’être envahie par un corps étranger – l’enfant à venir – qui porte atteinte à sa plénitude et la prive de la liberté, en particulier sensuelle, qui faisait naguère ses délices.
Cette liberté sans tabou, elle lui vient d’abord d’une enfance passée dans un pays équatorial, humide et chaud, que sa sensibilité exacerbée recrée dans la splendeur merveilleuse de commencements vécus en compagnie d’un frère qui fut, de fait, son premier amour.
Pascaline Mourier-Casile, née en Indochine, passe son enfance et son adolescence en Guyane. Universitaire, elle articule son activité d’enseignante, de chercheuse et de critique autour de la littérature française des XIXe et XXe siècles. Elle s’intéresse tout particulièrement au surréalisme – auquel est consacrée sa thèse d’État – et, d’une façon plus générale, aux rapports de l’écriture et de la peinture, aux résonances qui se trament entre les mots et les images. Parallèlement, elle produit ellemême des images peintes, jardin secret qu’elle avait – jusqu’à ce qu’elle se décide, ces toutes dernières années, à les donner à voir – toujours gardé par devers elle.
BONNES FEUILLES
La fente d’eau
PASCALINE MOURIER-CASILE
UN CRABE M’HABITE. Il fait son nid dans le sable de mon ventre. Un ver qui s’installe et se prélasse et s’enroule et m’emplit peu à peu.
Tout entière.
Je deviens coquille. Réceptacle. Cette gelée en moi qui gonfle, mûrit et se façonne me chasse de moi-même.
Depuis des jours.
Immobile. Je guette les moindres signes. Mon ventre respire. Il me semble qu’il bondit comme les collines du Cantique. En moi le bourgeon se gonfle, déplie ses feuilles et ses doigts. Se
lustre. Vagues larves. Pensées embryonnaires, qui jamais ne viendront au jour. Avortées. Je m’engourdis comme une anguille ivre.
Au début, la peur.
Tu restais calme, comme un qui voit, toute proche, l’issue. Moi, heurtée à tous les murs. Si peu de choses. Je parlais de clinique blanche, avec des fleurs sur la table et de beaux fruits lisses
dans une vasque de bois.
Clichés.
Ces choses-là sont courantes. Que crains-tu ? Au téléphone une dame prit rendezvous. Voix apaisante comme un verre d’eau fraîche. Bonbon acidulé quand on a la fièvre, la nuit. Moi, la bouche
feutrée par le goût des larmes. Charmante voix. Jolie femme ? Je l’imaginais discrète, efficace, avec de belles mains et une de ces bagues de turquoise brute que portent les grandes femmes
blondes à la peau brunie.
Je me rétracte. Me hérisse. Je ne veux pas qu’on me touche.
Je croyais la chose toute simple, cependant. Je suis libre. Je ne vais pas me laisser envahir de parasites. Notre amour souffrait de se voir garrotté. Pris au piège. Nous nous étions depuis cinq
ans voulus libres, unis seulement par ce choix délibéré que nous avions fait l’un de l’autre. Rien ne devait nous lier que cela. Notre amour ne se justifiait que dans sa gratuité.
Nous.
Coquille close, double valve accolée, opposant au monde une face lisse où rien ne devait accrocher.
Le vieux rêve, une fois brisé déjà : gémeaux.
(André et moi. Làbas, dans la ville morte. Le petit prince blond et son reflet, main dans la main, le long des eaux boueuses du vieux fleuve.
Autrefois.
Avant, bien avant cette dernière nuit où le miroir terni a volé en éclats.
Et tout ce sang, à jamais, entre lui et moi…)
De moi surtout venait ce repli. De mon enfance, là-bas.
Le long de ces cinq années, je m’étais efforcée de te déraciner, arrachant obstinément les radicelles, les liens qui te nouaient encore à d’autres, qui t’amarraient sur d’autres affections,
d’autres tendresses.
Lié.
Mais à moi seule. Et voici que j’étais désormais habitée de ce levain. Voici qu’en moi s’apprêtent d’autres racines, bien plus griffues que toutes celles que j’avais jusqu’ici tranchées.
Je croyais la chose toute simple. Mais l’emprise neuve du crabe installé en moi… Déjà chair tiède et moite, déjà nid, réceptacle, et ma volonté s’émoussait contre toute cette mollesse. Je me
croyais encore intacte. Mais déjà pourrissante. Rien de visible. Un corps devenu fouillis d’organes. Glandes molles, tiédeur, moiteur. Pomme déjà blette, saine encore d’apparence, mais si le
pouce pèse un peu trop sur la peau lisse, il s’enfonce dans une pulpe brune et parfumée.
Je ne veux pas.
Cette invasion, cette pénétration sournoise qui, insensiblement, me fond et me délite : je n’accepte pas. Mais j’avais beau me durcir, je n’étais plus que mollesse.
Dépossédée de moi.
Habitée.
Je te sentais déçu, surpris de me trouver femelle, toi qui m’avais faite à ton image. Je t’expliquais. Viol. Peur et révolte. Les mots coulaient de moi. Fades. Informes. Habités eux aussi de
cette même présence. Malgré la tendresse et les bras refermés autour de moi, la première faille s’ouvrait. Valves distendues. Je sentais la déception éclose en toi. Je savais que, pour toi aussi,
mon corps était désormais atteint d’une pourriture secrète. Côte à côte. Pour m’endormir, tu me nichais, comme toujours, au creux de ta hanche. Mais, dès que tu me croyais endormie – et je
mesurais mon souffle pour te libérer plus tôt, pour relâcher ce muscle que je sentais frémir sous ma bouche d’un décevant désir de fuite – tu glissais loin de moi, te repliais. Hors d’atteinte.
Et je restais, yeux clos, souffle égal, livrée à cette chose qui m’habitait et que je croyais sentir lever en moi. Lente. Infaillible. Toute-puissante.
Depuis des jours et des jours, la chose se prépare.
Dans le silence et l’immobilité d’abord, et je la pouvais ignorer. Je m’irritais pourtant de ces malaises où ma volonté ne jouait plus, de cette insidieuse mollesse qui me noyait. Longues heures
immobiles, tête vide, creuse, où rien ne passe, pas même un souvenir informe.
Mollesse, moiteur, je vous refuse. Répugnante, obscène, déjà vaguement habitée par la pourriture et la mort. Pourriture de mon enfance et de ma liberté, et de ma gratuité, quand je me dressais
nue sur les plages de l’île, parmi les scarabées morts de soleil et d’amour. Le soleil alors était pur et scarifiant. Moi, sèche et craquante. Prête à flamber. L’eau du bain séchait en un souffle
sur ma peau et la laissait toute poudrée de cendre blanche. Dure, et pleine et tout d’une pièce. Intacte. Statue, rien ne s’insinuait en moi. Inviolable, invulnérable, les vagues me roulaient
comme un galet. Comme un galet tu me tenais entre tes paumes. Lisse.
Ferme.
Dure.
Rose des sables, tes pétales s’érigent, et rien de toi ne cède. Tes éclats, au soleil, se feutrent de sable et de sel. Douce. Rêche. Tu es blessure et brûlure.
Quartz rose, ta
chair translucide semble humide, mais sèche sous la paume et compacte.
Journées compactes et légères, strictement cernées de leur écume de bonheur, comme l’île de son collier de sable.
J’écrivis, cette annéelà, le Cantique de l’Île :
Lassitude des jours heureux, cœurs dénoués. Soleils de mon été noyés au revers d’un juillet sans espoir. Soleils de mes étés, peau brûlée, sable chaud, crissement de lumière, je voudrais
m’éblouir.
Les guêpes aussi sont ivres, amour. Odeur de coquillage, goût de l’amour, noyé au revers de la dune, roulé dans cette vague dont l’écume s’attarde aux
doigts.
Je caresse les seins dorés de la plage, lente épave, mot mystérieux qu’inscrivent sur les dunes – arabesque, arabesque – la musaraigne et l’araignée des
sables.
Vibre, vibre au sommet de l’arc, le cri qui se déchire et déchire le ciel et dessine le vol ivre et doré des guêpes.
Au creux de cette dune tiède – méduse ou fleur
? fraîcheur de coquillage – ma vie est arabesque dessinée par ta voix.
Au creux de toi – fleur de sable, fleur de mer. Ma vie s’est endormie au creux de tes deux mains, et j’émerge de
toi, lovée contre ton flanc.
Plage, plage, ta peau de sable lisse est tiède à ma caresse ; j’émerge de la vague – fleur de mer, fleur de sable – qui vient de te
créer.
Bonheur sans résonance, coquille refermée sur l’amande et le cœur amer des souvenirs, nageuse ensommeillée, je dérive le long des vagues de l’oubli.
Le monde est
neuf – amour – l’été n’a pas de nom, mon corps ne connaît rien que le bruit de ton sang. Cette lueur bleuâtre est le premier matin.
Onde qui se retire et s’étire et meurt, au fond de
ton regard je trace – flux et reflux – la vague d’un regret qui rêve de l’été.
Été, je t’ai porté au creux de mes deux mains, au plus creux de ma solitude. Bel été, bel amour, je t’ai
porté au creux de mon corps, tiède, comme l’enfant qui lentement se membre.
Lourde – amour – de tout ton poids, je dérive, et les vagues se gonflent, ventre frais où se moule un corps
renouvelé, dans ta moiteur, sommeil d’avant la vie.
Mer enfantine et douce, voici que naît au creux de toi, au creux de moi – bel été, bel amour – nue sous le sable et
l’écume, l’enfance retrouvée.
Pascaline MourierCasile, La Fente d’eau, © MAURICE NADEAU, 2011
Philippe Croizon
Philippe Croizon par Frédéric Potet
Dans le Monde Magazine
|
|
Le Monde - il y a 2 jours
Ni gourou ni superhéros, Philippe Croizon a simplement transformé en force sa vulnérabilité – son incroyable vulnérabilité : celle d'un homme ayant perdu ...
|
"Ni gourou ni superhéros, Philippe Croizon a simplement transformé en force sa vulnérabilité – son incroyable vulnérabilité : celle d'un homme ayant perdu ses bras et ses jambes dans un accident il y a dix-sept ans. "Mon handicap, dit-il, est spectaculaire et il m'embête au quotidien. Autant qu'il soit utile." Utile à lui, bien sûr. Mais utile aux autres, à qui il inocule son irréductible envie de vivre. Dit comme cela, évidemment, la chose peut paraître abstraite, voire un peu naïve. Mais comment l'exprimer autrement ?
Depuis qu'il a traversé la Manche à la nage en septembre dernier, équipé de prothèses prolongées par des palmes, Philippe Croizon, 43 ans, est devenu un personnage familier des médias. Son exploit – 38,250 km de natation en 13h23 – a été relayé par un grand nombre de chaînes de télévision et lui a valu d'être reçu à l'Elysée par Nicolas Sarkozy.

Philippe Croizon et Arnaud Chassery s'entrainent pour leur prochain défi : rallier les cinq continents à la nage.Jean-Marie Heidinger pour "Le Monde Magazine"
Sans mauvais jeu de mots, cette prouesse lui a donné des ailes : d'ici un an, Philippe Croizon repartira nager dans des eaux aussi inhospitalières, mais plus lointaines. Son nouveau projet consiste à rallier les cinq continents en réalisant quatre traversées (voir l'encadré ci-dessous). Un nageur valide spécialisé en longue distance, Arnaud Chassery, l'accompagnera tout au long de ce périple riche en symboles.
Les deux hommes ont commencé à s'entraîner à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) en même temps qu'ils essaient de boucler le montage de leur expédition, dont le coût est estimé à 700 000 euros. "Franchement, je pensais que cela serait plus simple de trouver des sous", soupire Philippe Croizon, dont l'idée est de convaincre un gros sponsor qui prendrait à sa charge l'essentiel du budget. "Pourquoi pas EDF ?", lance-t-il tout de go. Provocation ? Non, un symbole de plus.
PATHOS PROHIBÉ
5 mars 1994. Ouvrier à Châtellerault (Vienne), Philippe Croizon monte sur le toit de sa maison afin de démonter l'antenne TV. Des câbles à haute tension passent à proximité. Un phénomène d'arc électrique injecte alors dans son organisme un flux continu de 20 000 volts. Grièvement brûlé, il est amputé de son avant-bras droit, des deux tiers de son bras gauche, de la moitié de sa jambe droite et de son fémur gauche.
Apprendre à vivre sans mains ni pieds mais avec un moignon et un genou pour seules terminaisons : tel sera son unique objectif au Centre de rééducation et d'appareillage de l'Institut Robert-Merle-d'Aubigné, à Valenton (Val-de-Marne). A force de musculation et de volonté, il en sort deux ans plus tard avec un niveau d'autonomie inespéré qui lui permet, à l'aide de prothèses et d'appareillages divers, de marcher, de s'alimenter, de conduire, de téléphoner ou encore de surfer sur Internet.

"Mon handicap est là et bien là. (...) Mais je suis désormais en osmose avec lui. On s'est apprivoisés lui et moi".Jean-Marie Heidinger pour "Le Monde Magazine"
Tout allait encore à peu près "bien". Un matin de 2001, sa femme Muriel, mère de ses deux enfants, le quitte. Une année de blues dominée par des bouffées suicidaires s'en suivra. Aidé d'un logiciel de dictée vocale, Philippe Croizon publie alors un livre à compte d'auteur, J'ai décidé de vivre, à la manière d'un exutoire. Une page dans Le Monde consacrée à son histoire lui permet de trouver un éditeur national (Jean-Claude Gawsewitch). Suivent des émissions de télé. Puis, par dizaines, des conférences en milieu scolaire et en entreprise.
Tel est encore aujourd'hui le gros de son activité quand il ne nage pas au milieu des dauphins (il en a vu dans la Manche) ou des requins (il en verra en Papouasie). Ses interventions en public sont des moments où le pathos est prohibé. Un seul fil rouge : l'humour. L'"homme en kit", comme il se surnomme, commence en général son exposé en faisant circuler dans le public sa prothèse myoélectrique composée d'une pince capable de tourner sur elle-même : "Au pique-nique, c'est moi qui m'occupe du barbecue !", lâche-t-il afin de décoincer l'assistance.
"Je dois briser la glace. C'est à moi de faire le premier pas. Et il n'y a qu'en racontant des blagues que c'est possible." L'humour n'empêche pas le maelström des émotions. L'autre jour à Rouen, un élève de 6e prend la parole à l'issue du débat : "Vous avez réalisé un défi incroyable en traversant la Manche. Moi aussi, j'aimerais réaliser un défi : vous faire un câlin." Geste adéquat d'un enfant ayant compris que le meilleur moyen de gratifier un homme-tronc de sa considération est de le prendre dans ses bras.
Un autre jour à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, c'est un jeune agriculteur venu spécialement des Ardennes qui s'approche de lui, à la fin d'une conférence publique : "Il venait de perdre ses deux fémurs à la suite d'un choc électrique, comme moi. Je lui explique qu'il a du bol dans son malheur car il lui reste les deux bras mais aussi les deux genoux, ce qui fait qu'il pourra nager et galoper comme un lapin avec des prothèses. Le mec n'a pas arrêté de pleurer devant moi. Il était inconsolable. Son accident était encore trop proche. Quelqu'un qui entre dans le monde du handicap peut mettre du temps à quitter sa phase de colère. Il n'a alors que sa chambre pour horizon et ne comprend pas que c'est à lui de composer avec le monde extérieur, et non l'inverse."
Philippe Croizon a adapté à sa sauce la célèbre phrase de Kennedy : "Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays." "Demandez à votre handicap de vous aider", formule-t-il aux handicapés qui viennent lui confier leur souffrance à la fin de ses conférences.
LE PRIX DE L'AUTONOMIE
Encore faut-il l'accepter, cette infirmité hors norme et révoltante. Se lancer des défis sportifs est un joli contre-pied à l'idée que l'on se fait du corps dans la société. Et peut-être un moyen d'oublier l'inacceptable ? "Non. Mon handicap est là et bien là. Il est même puissant. Mais je suis désormais en osmose avec lui. On s'est apprivoisés, lui et moi. J'ai accepté de ne plus faire ce qui m'est impossible." Encore que… Avec moult ingéniosité et force bidouillage, Philippe Croizon est capable de repeindre les volets de sa maison des environs de Châtellerault, d'arroser la pelouse, de passer la tondeuse, de jouer à la pétanque ou à la Wii.
Finie, l'époque où il harcelait au téléphone le secrétariat du professeur Jean-Michel Dubernard, à Lyon, dans l'espoir de se faire greffer un bras. "Je ne me vois pas repartir pour un an et demi d'hospitalisation. Encore moins prendre ces médicaments antirejet qui te bouffent de l'intérieur. J'ai accepté mon nouveau schéma corporel. De toute façon, ça ne repoussera pas. Je ne suis pas un lézard." L'humour encore. Et l'humour toujours quand, lors de ses conférences, arrive l'immanquable question sur sa vie sexuelle : "On m'a coupé quatre des cinq membres. Le cinquième fonctionne toujours", répond-il.
Ce qui fonctionne aussi, et surtout, c'est son couple avec Suzana, rencontrée sur Internet il y a quatre ans et demi. Cette mère de trois enfants avait besoin de "quelqu'un plein de vie et qui aime rigoler". Les deux se sont mis à la colle et ne se sont plus quittés. Suzana l'a poussé à gagner en autonomie : "Depuis son accident, Philippe a une tierce personne à la maison qui s'occupe de lui et il avait tendance à se faire cajoler comme un bébé. J'ai dû lui botter les fesses", raconte-t-elle.

Il a perdu ses bras et ses jambes dans un accident. A sa place, beaucoup se seraient laissés couler. Lui a traversé la Manche et enseigne le dépassement de soi.Jean-Marie Heidinger pour "Le Monde Magazine"
Sans Suzana, jamais il n'aurait réussi à traverser la Manche. C'est elle qui, en première ligne, a dû supporter sa fatigue et ses baisses de moral pendant les deux années d'entraînement intense qui ont précédé son exploit. "Que je puisse partager mon existence avec quelqu'un est la preuve que tout est jouable dans la vie, dit-il. J'ai longtemps cru que personne ne pourrait m'aimer avec un tel handicap. Après le départ de mon ex-femme, j'avais eu une première expérience avec une fille également rencontrée sur Internet, mais elle ne connaissait pas le monde du handicap et cela s'est mal fini. Or, il faut s'en occuper, d'un handicapé. Ce n'est pas marrant tous les jours. S'entendre dire “Excuse-moi chérie, mais il faut que j'aille aux toilettes et ensuite il faudra m'essuyer les fesses”, c'est moyen pour la libido. Grâce à Dieu, ou plutôt grâce aux toilettes japonaises, je suis désormais autonome à 100 %."
Sauf que l'autonomie a un prix : 5 000 euros les WC adaptés, 15 000 euros la baignoire pour personne à mobilité réduite, 50 000 euros la voiture avec un manche à la place du volant. Depuis peu, Philippe Croizon fait payer ses interventions en entreprise. "Un jour chez PSA, je vois un non-voyant qui participait à la même conférence que moi recevoir un chèque de 1 000 euros. Et moi, ceinture ! “Vous n'avez qu'à créer votre société”, m'a dit le gars de PSA. C'est ce que j'ai fait." Un groupe de patrons belges l'a récemment invité à dîner à Bruxelles afin de l'entendre parler du dépassement de soi. Fin mai, c'est le président d'un club de foot professionnel – le FC Sion – qui lui a demandé de venir motiver son équipe à la veille de la finale de la Coupe de Suisse. Finale remportée par l'équipe en question (2-0).
Doper le moral de jeunes cadres en manque d'énergie, booster celui de dirigeants en mal de motivation, raconter à l'envi pourquoi il "a décidé de vivre" et de bien vivre, c'est ainsi qu'il voit son avenir. Il imagine créer une petite entreprise de coaching. Ce sera dans deux ou trois ans. D'ici là, il lui reste juste une dernière bagatelle : rallier cinq continents à la nage. Sans bras ni jambes.
Le Une du "Monde Magazine" daté du 20 août 2011.DR
Son corps extrême
L'essentiel vu par l'auteur
J’ai longtemps fréquenté les hôpitaux comme auxiliaire médicale. J’y suis souvent retournée par l’écriture. Un
hôpital est une grosse machine cliquetant comme un Tinguely, une entreprise pleine de mouvements et de bruits, de circuits électriques, de pompes, de lumières, de matériaux radioactifs, avec du
plâtre, et des clous, des vis… L’hôpital est aussi vivant et bruyant qu’un chantier d’autoroute.
Aux yeux d’Alice — que j’ai choisi de nommer ainsi pour Lewis Carroll et les folles modifications du corps de son héroïne au cours de ses aventures —, l’hôpital est
surtout un chantier organique. Le corps comme acteur et comme oeuvre ne devrait pas être exclusivement réservé aux plasticiens et aux performeurs. La patiente, se remodelant, s’exhibe en pleine
performance, dans un authentique art du corps.
Il m’a également semblé essentiel de montrer quelle peut être la résonance politique des soins hospitaliers, depuis le service de réanimation, sans doute le plus
haut lieu de surveillance technocratique, jusqu’au centre de rééducation, où se côtoient, démocratiquement, des bancroches et des manchots de milieux divers, avec des philosophies et des
approches de la vie extrêmement variées.
L’hôpital, comme le monastère ou la prison, est par excellence le lieu de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la prise de conscience : telle est la
mission de l’alitement forcé, faire qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. Pour l’écrivain comme pour son personnage, il arrive qu’un tel séjour apparaisse soudain comme une nécessité
inévitable, absolument pas au sens médical mais dans un sens existentiel. Voir à ce propos L'exercice de la vie.
> L'avis de l'éditeur
Ebranlée dans sa chair par un accident de voiture, Alice vit heure par heure les mutations de son corps à
travers l’expérience de la cicatrisation, de la consolidation, de la musculation. Prélude à une renaissance dans un corps différent, rejoué, renégocié, ce voyage dans le chantier organique et le
monde clos qu’est l’hôpital est aussi un roman puissamment initiatique sur les séductions exercées par la mort et la maladie à certaines étapes de l’existence, quand s’instaure un rapport inédit
à la vérité, voire à une forme de spiritualité.
« L’artiste, l’écrivain en particulier, qui ne va pas de temps en temps dans un hôpital, donc ne va pas dans un de ces districts de la pensée, décisifs pour sa vie, nécessaires à son existence,
se perd avec le temps dans l’insignifiance parce qu’il s’empêtre dans les choses superficielles. (...) Dans ce district de la pensée, nous atteignons ce que nous ne pouvons jamais atteindre hors
de celui-ci : la conscience de nous-mêmes et la conscience de tout ce qui est. »
Thomas Bernhard
Victime d’un grave accident de la route, Alice, bientôt
cinquante ans, retourne à un état proche de la vie embryonnaire. Plongée dans un coma léger, elle vit au rythme artificiel du moniteur respiratoire et des sons qu’elle perçoit. Le son que fait la
vie à l’intérieur de son corps. Autour d’elle, au-dehors, la moindre palpitation, le moindre souffle ou frôlement, acquièrent une puissance inédite, revêtent, au cœur de cette métamorphose
immobile, une qualité sensuelle jamais éprouvée. Quand elle reprend conscience, Alice entre dans une phase de rééducation qui durera deux ans. Depuis son présent en forme de bulle où la vie n’est
plus que fonctions, Alice projette des images, comme autant de radiographies de son passé – lorsque la vie était histoire.
Ces images sont celles d’une mère qui a naufragé dans la dépression alors qu’Alice n’était âgée que de quelques mois. D’un père aimant, remarié avec une
artiste-peintre qui n’adresse pas la parole à la petite fille. D’un frère, de sept ans son aîné, laissant derrière lui le monde pour entrer en religion, à peine sorti de l’adolescence. D’un mari
honni et d’un fils belliqueux qui, pareil à du sable, lui file entre les doigts quand il ne lui pique pas les yeux. Et, au centre de la ronde familiale, les images d’une Alice fragile,
momentanément comblée par sa maternité mais très vite en proie à un malaise intérieur qu’elle ne maîtrise ni ne comprend, et qui la ronge, la défait, la défigure, la bouleverse, détruit son
mariage et corrompt sa relation avec son fils. Coupée du monde extérieur, en exil dans l’univers insulaire de l’hôpital, et lavée de ce qu’elle nomme la “saleté affective”, Alice, aux prises avec
de folles mutations mais bien loin du pays des merveilles, se recentre sur son corps meurtri et lutte pour en reprendre possession. Vit l’expérience, impitoyable, de la cicatrisation, de la
musculation, de la rééducation, de la reconstruction.
Pure entité soudain revenue à l’état de quasi nourrisson, cette femme sans attaches doit aussi retrouver le langage perdu, et tracer, écrire, chaque nuit, des
mots-onguents sur une feuille de papier dont les lignes soutiennent mieux que les jambes. Ecrire “jusqu’à ce que de la vie s’accumule dans un coin”. Alors qu’elle entame cette lente reconquête,
Alice se rapproche d’un autre patient, Caire, un homme marié et père de famille. C’est auprès de lui qu’elle trouve l’envie de se relever, sous son regard qu’elle réapprend à marcher, et au cours
de l’une de leurs conversations qu’elle expulse le traumatisme enfoui. La chose inscrite dans son corps, si présente dans son absence qu’elle a jusqu’alors été incapable de s’en souvenir — et,
tout autant, de l’oublier...
Interrogeant l’absurde et profane mystère de toute incarnation, Régine Detambel, à travers la trajectoire médicalisée d’un être qui renaît de ses cendres,
cartographie avec une autorité inspirée le fascinant territoire du corps mortel, et propose, avec ce bouleversant voyage dans le chantier organique et le monde clos et tyrannique qu’est
l’hôpital, un roman puissamment initiatique sur la sculpture du vivant et sur les séductions exercées par la mort et la maladie à certaines étapes de l’existence, quand s’instaure un rapport
inédit à la vérité, voire à une forme de spiritualité.
> Plus de détails
Son corps extrême est un roman dont le moteur est la guérison. Alice, son personnage principal, est ébranlée et transformée dans sa chair par un accident
de voiture, qui n’est peut-être pas seulement dû à un hasard malchanceux. Elle va vivre heure par heure les transformations de son corps au travers des expériences profondes de la cicatrisation,
de la consolidation, de la musculation. Et surtout elle va jouir de l’immense pouvoir de régénération de son corps.
On a traité de la cicatrice en littérature, de sa forme, de sa profondeur. De la cicatrice comme d’un événement plastique, d’un tatouage individualisant. Mais il me
semble que l’on n’a presque jamais parlé de la cicatrisation comme processus, de l’immense capacité romanesque de notre pouvoir de cicatrisation, ni d’ailleurs de notre faculté de consolidation
(régénération du tissu osseux après une fracture).
J’ai toujours trouvé que la littérature était très en retard, trop, sur les arts plastiques. Et depuis toujours j’écris le corps en regardant de près les créations
artistiques contemporaines : les os dans La ligne âpre (éditions Christian Bourgois), les
blessures de l’enfance dans Blasons d’un corps enfantin (Fata Morgana), où je montre que les
égratignures, les écorchures, les éraflures, les griffures de l’enfance rejoignent certaines pratiques d'artistes de l'art corporel dans les années 60-70, et bien sûr la peau dans le Petit éloge de la peau (Folio). L'utilisation du corps comme support de l'œuvre ne devrait pas être
exclusivement réservée aux plasticiens et aux performers. Or, en parlant d’un corps blessé, hospitalisé, puis se resculptant, je me sens en pleine performance, tout simplement parce qu’un patient
hospitalisé dont les tissus sont en train de se reformer est aussi en pleine performance, en plein art du corps.
Un hôpital est un chantier organique. Tous les corps qui y sont allongés, apparemment passifs, bâtissent, fondent, sécrètent des choses invraisemblables,
architecturales, esthétiques ou non, dans les expériences positives très profondes et très fortes de la cicatrisation, la consolidation, la musculation… La guérison est une construction. Une
dynamique puissante. Et puis l’hôpital est aussi une grande machine à fric, oscillant, cliquetant comme un Tinguely, une entreprise pleine de mouvements et de bruits, de circuits électriques, de
pompes, de lumières, dans les cris, les va-et-vient des véhicules qui apportent du sang et des médicaments, des bonbonnes d’oxygène, des matériaux radioactifs, du plâtre, des clous, des vis…
L’hôpital est aussi vivant et bruyant qu’un chantier. C’est pourquoi Son corps extrême s’ouvre sur un chantier d’autoroute et se poursuit tout naturellement dans le grand chantier
hospitalier.
Ce qui occupe Alice, l’ouvrière de son propre chantier, la «guérissante» à l’oeuvre, est essentiellement la bataille physique, profonde, intime : « La plupart du
temps, Alice ne s’inquiète pas de la marche des heures. Le jour avance. C’est déjà le soir et rien de remarquable n’a été accompli. Mais au fond des plaies qui n’ont pourtant l’air, vues de
l’extérieure, que d’un inextricable fouillis, c’est l’entrain et la révolution. Les cellules sécrètent du collagène, les vaisseaux bourgeonnent puis s’unissent pour former des arches qui
s’allongent et prolifèrent, les os fabriquent des cals, ça valse, ça lutte, ça phagocyte, ça se divise et ça se reproduit à tire-larigot, et tout ce populo est bien résolu à former un corps à
nouveau digne de ce nom. Des transformations silencieuses. Croire en la passivité d’une malade est un affront. On imaginerait à tort la vie d’Alice comme une vie murée et incapable. Qu’est-ce que
vous avez donc de si important à faire ? s’étonne pourtant une petite dame aux mollets durs, avec un long nez, sa douzième compagne de chambre. Elle imagine peut-être qu’Alice a entamé une longue
carrière d’invalide et traînera désormais sa carcasse d’ennui, de culpabilité et de remords jusqu’à la prochaine décennie. »
L’hôpital est un lieu romanesque puisqu’il est par excellence celui de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la prise de conscience : telle est la
mission de l’alitement forcé, faire qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. L’hôpital est le lieu où se jouent souvent les expériences humaines les plus fortes de conscience de soi. On
n’y va pas pour rien. Mais quand on y va, on est sûr qu’on y entretiendra des pensées qui sont nouvelles, sur la mort, sur ce qu’on est au fond, sur ce qu’on attend de la vie ici et maintenant et
aussi quand on sortira, si on s’en sort. Quelque chose d’urgent se précise et on se met à se dire la vérité à soi-même. C’est Thomas Bernhard, dans Le Souffle, qui a rendu compte
magistralement de cet état de fait. Bernhard a fait lui-même l’expérience de l’hôpital durant son adolescence et ce séjour lui était apparu soudain comme une nécessité inévitable, absolument pas
au sens médical mais dans un sens existentiel. Il développe la thèse que l’écrivain a l’obligation d’aller de temps en temps dans un hôpital ou une prison ou un monastère. Ces lieux ont les mêmes
pouvoirs à ses yeux. C’est uniquement là-bas, dit-il, que nous atteignons ce que nous ne pouvons jamais atteindre dans la vie ordinaire : la conscience de nous-mêmes et la conscience de tout ce
qui est. De l’hôpital comme lieu de haute spiritualité ! On peut donc considérer que tout patient est profondément pensif.
Quand on est hospitalisé, alité, on n’a pas l’air de travailler mais on fournit pourtant un effort exceptionnel et, surtout, on ne peut pas s’empêcher de guérir.
Même si quelqu’un meurt près de vous, vous guérissez quand même, vous poursuivez votre course vers la guérison, c’est puissamment animal. Quelque chose d’effroyablement fort (et par là de
follement romanesque) est en marche. Cette joie majeure, cette force invincible est ce que ressent Alice dans Son corps extrême, et cette joie, cette force animale prennent le temps de
vitesse, à tel point que « pendant quelques mois, guérir est plus rapide que vieillir et même renverse la vapeur. On rajeunit. » C’est sans doute cette joie dilatatrice qui a donné, dans les
mythes humains, la certitude qu’il existe un élixir de jouvence. Le séjour d’Alice à l’hôpital, puis en centre de rééducation, a donc cette vertu. De régénération. De guérison. De nouvelle
morphogenèse, sorte de renaissance dans un corps différent, rejoué, renégocié par la cicatrisation, par la consolidation, par la musculation. Comme une deuxième croissance à laquelle cette fois
elle serait attentive. Le corps est le lieu où nous pouvons changer réellement notre vie, la manière dont nous percevons notre vie.
« Quand donc a commencé la guérison ? [se demande Alice]. Une chose est sûre, tout a changé sous ses yeux sans qu’elle s’en aperçoive et jusqu’à la façon dont les
néons éclairent le grand couloir. Un grand chavirement s’est produit et maintenant voilà que le déclin lui-même décline. Les plaies s’assouplissent, les œdèmes se résorbent, les muscles
rosissent, les formes saillent et le visage devient plus mobile. Et aussi le teint, la peau, tout, c’est-à-dire que rien n’échappe à l’amélioration : le regard aussi guérit et le sourire et le
timbre de la voix et le geste de la main, tout guérit, à la molle vitesse des saisons, y compris la marche elle-même, bien sûr, et fondent peu à peu les semelles de plomb. Pendant quelques mois,
guérir est plus rapide que vieillir et même renverse la vapeur. On rajeunit.
Et dans les plis de ce nouveau monde qui attend Alice, il doit bien y avoir un lieu vierge où démarrer quelque chose. »
Un centre de rééducation peut faire parfois penser à un camp de travail. Ce mot de rééducation lui-même peut faire penser aux systèmes totalitaires, à une sorte de
Kolyma… Orthopédie vient du grec orthos, qui veut dire «droit». Vous ne sortirez pas de là tant que vous ne marcherez pas droit ! On traque l’asymétrie, la boiterie, tout ce qui est
anormal, au cours de torturantes séances de rééducation. Mais un centre de réadaptation fonctionnelle est tout de même une version légère du service de réanimation hospitalier qui est lui un
système totalitaire où l’on vous surveille sous tous les plans, où l’on vérifie en permanence votre fréquence cardiaque, votre volume urinaire, les gaz pulmonaires que vous expirez. C’est le plus
haut lieu de surveillance technocratique. Après son accident de voiture, Alice va parcourir tous les systèmes politiques, de la réanimation, avec sa loi d’airain, jusqu’au centre de rééducation,
qui est au fond démocratique parce que s’y côtoient des dizaines d’êtres différents, de milieux divers, avec des philosophies et des approches de la vie extrêmement variées. Je me demande parfois
si l’hôpital universitaire n’est pas le dernier lieu démocratique de la planète.
Toutefois, son séjour en centre de rééducation donne à Alice l’occasion de rencontrer une galerie de personnages bancals ou manchots, occupés à redécouvrir les
gestes les plus simples de la vie quotidienne. Face au miroir quadrillé de la salle de musculation, Alice reprend corps au milieu de ces êtres qui s’occupent aussi peu des affaires du monde que
s’ils descendaient de la lune et ne parlent que de choses concernant leur guérison espérée, un monde où l’anormal devient la norme, où personne ne marche droit, où les orthopédistes font régner
un ordre totalitaire au cours de torturantes séances de rééducation, faisant du centre de rééducation d’aujourd’hui l’équivalent des sanatoriums et autres «montagne magique» où d’apparents oisifs
se mettaient à penser. Sauf que dans La Montagne magique, il me semble que l’on a surtout un lieu de repos, de répit, de réflexion distanciée sur le monde d’en bas et sur la mort, tandis
qu’au centre Alice est soumise en permanence à un entraînement intensif, et qu’elle finit par vivre ce séjour comme une expérience de ski extrême. J’avais lu un jour dans les Notes sur
Hiroshima de Oê Kenzaburo qu’une femme pleurait de joie et remerciait les médecins après avoir réussi à remarcher durant huit mètres. C’est cela que j’ai voulu rendre dans Son corps extrême,
cette disproportion des émotions et des résultats. Une victoire sur soi-même n’est pas mesurable avec les critères du sport olympique. C’est une tout autre dynamique. Morale. Mentale.
Symbolique.
Métamorphosée par le faisceau d’influences de Mme Oswald, sa voisine de chambre miraculée, d’Antoine Caire, l’amant éclopé, Alice réapprend à marcher, littéralement
mais symboliquement aussi. Le vertige qui la guette à chaque pas ranimera un traumatisme d’enfance, une ineffable chute dans le vide, entre les bras de sa mère. Ce roman initiatique place Alice
face à la séduction de la mort et de la maladie à certaines étapes de l’existence. Son passé s’incarne dans un effroyable vertige, un désir actif de se jeter dans le vide qui l’effraie
épouvantablement. Pour me familiariser avec ces notions, j’ai lu quelques livres sur le vertige et sur le désir actif de se jeter dans le vide, livres de psys le plus souvent, mais aussi
d’alpinistes. C’est une émotion passionnante, qui noue le corps au plaisir, à la peur. Difficile d’ailleurs d’écrire sur/depuis le vertige car l’écriture elle-même, à certains moments, doit jouer
à perdre son centre, à n’être plus d’aplomb, à s’emballer.
J’ai évidemment choisi ce prénom d’Alice pour Lewis Carroll et les incroyables modifications du corps de son héroïne au cours de ses aventures. Alice va vivre les
mêmes métamorphoses profondes, biologiques d’abord puis (comporte)mentales. Elle passe son temps à jouer avec les limites de son corps. Avec les limites de son existence aussi, abordant notamment
la question de l’amour, car Alice a une vie antérieure plutôt ratée, avec un ex-mari, un fils, un frère bien-aimé. Et puis elle fait la connaissance de Caire. Mais le danger est toujours de
rejouer une histoire d’amour ou de maternité selon le scénario habituel. Elle va être obligée de reconsidérer tout son mode de perception de la vie. Parlons des maux que soigneraient l’amitié et
l’amour des êtres qu’Alice a rencontrés au centre. Ils sont innombrables : l’ignorance, la tristesse, l’isolement, le sentiment de l’absurde, le désespoir, le besoin de sens… parmi quelques
autres. C’est que cette drôle de vie en communauté est aussi un scalpel, un outil de compréhension de soi-même et du monde, sans quoi le passé d’Alice lui resterait opaque comme aux premiers
temps et l’idée même d’avancée serait caduque. Elle va se déchiffrer peu à peu. Penser. Critiquer. Juger. S’interroger. Se confronter à d’autres. La chose, paraît-il, n’est pas gagnée d’avance
!
> Extrait
"On ne s’éveille pas vierge d’un coma. Même si on a l’impression, un temps, que tout est blanc, il y a eu les cauchemars. Les démons hantent le silence et s’en
nourrissent, ils sont la face vénéneuse des choses dont on avait si peur dans la chambre d’enfant, ils sont l’ombre de l’armoire, ils sont la tache de moisi sur la toile de Jouy qui, dans la
presque obscurité, avait l’air d’une tête de mort, ils sont des âmes en peine et des spectres condamnés à une course désordonnée et éternelle.
On ne s’éveillera plus jamais vierge. Les plis sont marqués partout. La preuve, c’est qu’on n’a pas toute la vie à retraverser quand on rouvre les yeux, un beau
matin, dans un lit surélevé et muni de manivelles commodes. On n’a pas grand-chose à passer en revue, excepté ses abattis peut-être. Mais le fait d’être femme, le fait d’être mère, le fait de se
demander si on est folle ou saine, tout revient aussitôt, le fardeau, le fagot, le paquet de souvenirs mouillés comme du linge lourd lui reviennent en pleine poire. Alice sait déjà tout, les
scandales sont restés des scandales, les bonheurs sont toujours lumineux. Rien de changé. Rouvrir les yeux sur un matelas à eau de quarante centimètres d’épaisseur n’a créé aucun court-circuit
déroutant. Et bien que son existence ait été largement éventrée et retournée par l’événement, Alice appartient toujours au même règne, à l’embranchement souhaité, pointe dans la classe idoine,
évolue dans l’ordre, la famille, le genre et l’espèce ad hoc. Elle n’a pas eu droit à du neuf. Elle a remis sa vieille vie, d’occase, et replantera ses pieds dans les mêmes ornières. Rien n’a
fait surgir de son être psychique des combinaisons fantastiques ou subtiles, elle se retrouve comme devant, déjà bouleversée, déjà infiniment angoissée, avec la peur et la rage au ventre, qui
déploient leurs fastes et hissent leurs drapeaux.
Elle s’éveille donc seule, David a disparu. Pour les différends, du moins, ils se sont toujours bien entendus et Alice ne perd rien à émerger dans cette réalité-là,
avec pour seul nuage une poche de glucose au-dessus de sa tête et pour tout roulement de tonnerre le rire bête et bienfaisant de la famille banale qui visite sa voisine de chambre. Elle a la tête
effroyablement lourde, gourde, elle est toujours en retard d’une réplique et son intelligence traîne derrière elle, égarée quelque part dans l’épave de la voiture ou sous le lit ou dans le tiroir
de la table de chevet avec les protège-slips, un miroir inutile et des sucrettes. Elle somnole dans ce monde complet, ouaté et glougloutant. Ses pensées forment une matière légère, alvéolée. Et
le vide apparent dans son crâne tient à l’allongement inouï des temps de pose entre deux réflexions, si bien que chacune de ses journées se love dans une seule image qui suffit à la condenser.
Les heures se remplissent d’elles-mêmes d’une sorte de matière sans valeur, de billes de polystyrène, de bulles de plastique qui n’ont ni goût ni couleur. L’extrême de l’allègement. Alice jouit
du bonheur de se fondre dans la masse, de n’avoir plus à décider du bien et du mal. Aubaine que d’être dépouillée de la pénible tâche de penser, libre du carcan des conventions et des manières,
ne répondant rien quand on lui parle, n’ouvrant pas la bouche quand on lui donne à manger. Le vide est un baume aux tourments de soi. Une terrible et merveilleuse dispense d’humanité.
Portée par la morphine, Alice goûte une paix royale. Il faut atteindre parfois la très grande vieillesse pour la trouver enfin. Des femmes de quatre-vingt-seize ans
ne se souviennent pas de leurs enfants, même pas d’en avoir eu, elles disent c’est si loin maintenant, et elles sont vraiment tout à fait tranquilles.
Des idées qu’elle a hébergées jusque-là sans raison la quittent tandis que d’autres, à l’apparence neuve, viennent s’installer dans cette carcasse paisible qui
paresse toute la journée. La fièvre travaille à l’engourdir, Alice souhaiterait que ça dure jusqu’à la mort mais elle sent déjà que viendra la douloureuse guérison, qui gratte, qui pique, qui
démange, qui lance, qui recolle, qui retape. Cette espèce de grosse paysanne inusable qu’est la vie, bouffie de forces, gaie et quasiment aveugle, est en train de la sarcler au plus
profond."
> Ouvrages de l'auteur abordant les mêmes thématiques :
Petit éloge de la peau (Folio, 2007)
La chambre d'écho (Le Seuil, 2001)

















